Interview par Peter Hossli

La première fois que vous avez senti, enceinte, votre enfant bouger, vous passiez la frontière pour entrer en Somalie. Qu’est-ce qui vous a traversé l’esprit à ce moment-là?
Lynsey Addario: Ce fut une période difficile pour moi. Le fait d’être enceinte me procurait des sentiments contradictoires, et j’ai longtemps refoulé mon état. Je voulais une famille, c’est certain, mais je ne savais pas comment concilier cela avec mon métier de photographe et mes déplacements constants. Je n’avais pas de véritable modèle: aucune autre photographe ne travaillait comme moi tout en ayant une famille..
Comment avez-vous réussi à gérer ces contradictions?
En continuant simplement à travailler et à prendre des photos dans les mêmes endroits que d’habitude.
Certains vous reprochent votre inconscience. La Somalie, après tout, n’est-elle pas un des pays les plus dangereux du monde?
Ceux qui disent cela oublient que les femmes somaliennes attendent également des enfants et donnent la vie tous les jours. Pourquoi ne s’inquiètent-ils pas pour ces femmes, en Somalie, qui accouchent dans ce contexte?
Vous-même, vous considérez-vous comme inconsciente?
Non, je ne me vois pas comme cela. J’ai passé quatre jours en Somalie pour y photographier les conséquences d’une grave sécheresse. Il n’y avait pas de combats.
Vous vous êtes toutefois exposée à des dangers inutiles, enceinte de votre enfant.
Ma grossesse s’est très bien passée, j’étais en très bonne santé. Plutôt que de faire des reproches à une journaliste qui part quatre jours en Somalie, vous devriez plutôt vous préoccuper des femmes somaliennes!
En Somalie, vous avez photographié des enfants malades, qui avaient besoin de soins. Avez-vous pu les aider avec votre appareil photo?
Voyez-vous, je suis journaliste, tout simplement. Je n’ai aucun problème avec le fait de photographier des gens malades. Lorsque je montre leur état, lorsque je montre que des centaines d’enfants souffrent de sous-alimentation dans la corne de l’Afrique, frappée de plein fouet par la sécheresse, les choses bougent. Les organisations humanitaires arrivent pour soutenir la population. C’est en cela que je suis utile avec mon appareil photo.
Le journalisme n’est pas un métier comme un autre. Nous nous définissons par notre travail. Pour vous, que représente le journalisme?
Je ne le fais pas pour l’argent, je le fais parce que j’y crois vraiment. Le public doit constater de visu ce que les gens vivent ailleurs sur la planète. Nous devons comprendre pourquoi et où se produisent les crises humanitaires, où les droits humains sont violés, où la guerre fait rage. C’est notre devoir d’aborder ces sujets et de nous demander quelle aide nous pouvons fournir.
En Somalie, vous avez photographié un enfant en train de mourir alors que vous étiez enceinte. Que ressent-on dans un moment comme celui-là?
C’est toujours terrible et traumatisant de voir un enfant mourir, que l’on soit enceinte ou pas. Mais c’était encore plus perturbant lorsque j’attendais mon fils et que je le sentais bouger dans mon ventre. Néanmoins, je préférais être en Somalie, l’appareil photo à la main, et avoir l’impression d’être utile, plutôt que de rester à la maison et de profiter de ma vie, somme toute privilégiée, les bras croisés.
Aujourd’hui, vous êtes maman. En quoi cela change-t-il votre rapport à la souffrance que vous photographiez?
Ma compréhension est devenue encore plus aiguë. J’éprouvais déjà de la compassion avant: j’ai toujours essayé de comprendre ce que les gens vivaient. En tant que mère, je comprends à présent vraiment le lien qui nous relie à un enfant, cet instinct irrépressible de le garder en vie et en bonne santé, d’assurer sa sécurité et de lui procurer tout ce dont il a besoin.

Je ne vais plus au front. Je continue à travailler dans les zones en guerre, je travaille en Irak et en Afghanistan, mais je reste davantage à l’arrière. Je me concentre sur la population civile; en ce moment, je suis de nombreux réfugiés. Et j’essaie de travailler un peu à l’écart de la ligne de tir.
La qualité d’un journaliste se mesure, dit-on, à celle de son dernier reportage…
Naturellement…
… dans quelle mesure avez-vous craint de ne plus être à la hauteur après la naissance de votre enfant?
Oh, j’avais terriblement peur. J’éprouvais des sentiments si contradictoires à l’idée d’avoir un enfant, parce que je n’arrivais pas à m’imaginer comment continuer à travailler tout en étant mère. Je ne savais pas si je pourrais continuer à voyager comme avant, si je pourrais laisser mon fils seul. En tant qu’adulte, une seule chose a toujours compté pour moi: mes reportages.
Votre rapport au travail est impressionnant. Qu’est-ce qui vous fait avancer?
Je me mets moi-même énormément sous pression. Mes parents travaillent très dur et ils m’ont inculqué, lorsque j’étais enfant, une éthique de travail exigeante. Mes grands-parents sont Italiens, une de mes grands-mères est arrivée du sud de l’Italie aux Etats-Unis par Ellis Island. Mes grands-parents étaient très pauvres, ils ont dû tout acquérir à la sueur de leur front. C’est probablement de là que je tiens mon rapport au travail.
Et comment parvenez-vous à vous reposer?
Aucune idée. J’aimerais bien le savoir.
De nombreux photographes de guerre sont accros à l’adrénaline. Et vous?
Lorsque je me trouve dans une zone de combats, et que l’on me tire dessus, je sens l’adrénaline monter, c’est sûr. C’est le cas pour tout le monde. C’est un des phénomènes naturels de la guerre. Mais je m’intéresse bien plus aux histoires, aux lieux où je réalise mes reportages. Je me considère comme une messagère qui décrit ce qui se passe. Voilà ce qui me fait avancer. L’adrénaline est présente dans les combats, mais ceux-ci ne représentent au maximum que 5% de ce que je fais.

Le terme de «photographe de guerre» m’embarrasse un peu, car je ne suis pas une bonne photographe de combats. Il est vrai que j’ai souvent travaillé dans des zones en guerre. Mais la plupart du temps, je raconte l’histoire de civils dans des régions en crise.
Pourquoi n’aimez-vous pas le terme de «photographe de guerre»?
Parce qu’il ne s’applique pas à moi. De nombreux photographes ne photographient que la guerre. Ce n’est pas mon cas. Même lorsque je me trouve dans une zone en guerre, je me concentre rarement sur les combats.
Dès qu’une tragédie se produit quelque part, vous y allez. N’est-ce pas une forme de dépendance?
Non, je pense que c’est une vocation. Je crois en mon métier, et je vois l’influence que j’exerce. Je montre des personnes, l’aide qu’ils apportent. Des gouvernements réagissent à mes images. Et quand je vois tout ça, je me dis que je ne peux pas m’arrêter. Il ne s’agit pas d’aventure. Je ne suis pas de nature téméraire. Le terme de «dépendance» que vous utilisez me déplaît fortement. Il est si superficiel. Il dévalorise les gens qui ont consacré leur vie à quelque chose d’important.
Le photographe Robert Frank m’a dit un jour que les gens du métier, auparavant, étaient davantage prêts à se battre pour une photo. Aujourd’hui, c’est difficile. Comment gagnez-vous la confiance des gens que vous photographiez?
En reportage, je prends réellement le temps de parler avec les gens, de leur expliquer pourquoi je suis là et pourquoi je pense qu’il est important de raconter leur histoire. Je ne me mets pas à photographier tout de suite. Lorsque je commence, les gens se sentent à l’aise et comprennent ce qui m’intéresse. La semaine dernière, j’étais en Inde, et j’ai pris des photos dans une maternité. C’était un sujet très intime. J’ai simplement parlé avec ces femmes auparavant, j’ai passé du temps avec elles. Ce n’est pas mon style de me contenter de gesticuler devant des visages avec mon appareil photo.

Cela ne joue aucun rôle d’être une femme ou un homme dans une zone de guerre. Tout se passe très vite, et ne dépend que de ce qu’on cherche et de la rapidité de réaction.
Vous travaillez souvent dans des pays musulmans. Est-ce difficile pour une femme?
Lorsque j’effectue un reportage dans le monde musulman, c’est un immense avantage d’être une femme, car ce sont des sociétés dans lesquelles les femmes et les hommes vivent séparément. En tant que femme, j’ai un accès privilégié au monde féminin en terre d’islam.
Vous avez été enlevée en Irak, puis plus tard en Libye. La faute à qui?
J’en suis la seule responsable. Je savais dans quoi je m’embarquais. Tous les reporters de guerre s’exposent à des dangers. Nous acceptons le fait qu’il peut se passer des choses, surtout en Libye. Je suis reconnaissante d’être toujours en vie.
Vous vous êtes sentie coupable parce que les hommes enlevés avec vous ont subi de plus mauvais traitements. Pourquoi?
Mes collègues criaient parce que les ravisseurs les frappaient avec la crosse de leurs fusils. Ils m’ont épargnée uniquement parce que je suis une femme. Lorsque j’ai entendu les cris des hommes, j’ai pensé que c’était injuste.
Vous avez subi des attouchements. N’était-ce pas effrayant?
Bien sûr que si, c’était répugnant et effrayant. J’avais surtout horriblement peur d’être violée. Mais j’ai entendu mes collègues gémir et j’ai senti que je serais traitée différemment parce que j’étais une femme. J’en ai alors éprouvé de la honte.
Vous n’avez pas été violée. Savez-vous pourquoi aujourd’hui?
Principalement parce que je n’ai heureusement pas été séparée de mes trois collègues masculins. Une nuit, un type est entré dans notre cellule. Nous étions tous endormis. Mais j’ai entendu le cliquetis de la porte. Il m’a attrapée par un pied et a tenté de me traîner dehors. Alors je me suis simplement cramponnée à Anthony Shadid, je me suis blottie contre lui comme s’il était mon mari. J’ai murmuré son prénom. Le type nous a regardés, et s’est volatilisé.
Vous avez photographié une femme qui avait été violée par neuf hommes. Comment parvenez-vous à gérer une telle souffrance?
Par mon travail! Et en montrant mes photos au monde entier. Peu importent les choses terribles que je vis. L’important, c’est d’aider les personnes que je photographie.
Vous avez été confrontée non seulement à la violence, mais aussi à la cruauté. Cela a-t-il influencé votre vision de l’humanité?
Toutes ces choses, je ne les vis pas entre parenthèses. Elles m’accompagnent partout et toujours. J’ai vu ce que les êtres humains sont capables de faire, la cruauté, l’agressivité, la violence. Et j’ai vu aussi qu’ils pouvaient être exactement le contraire: des êtres magnifiques et généreux.
Est-ce important pour vous de rester neutre dans un conflit?
C’est capital. Ma mission est de rapporter ce que je vois et de le rendre public. Naturellement, j’ai ma propre opinion, mais peu m’importe la façon de penser de ceux que je prends en photo. Je fais des interviews, des photos, et je transmets le matériel au «New York Times» ou au «National Geographic».

Cela me touche énormément. Si je me rends à présent plus rarement sur les champs de bataille, c’est non seulement parce que je suis devenue mère, mais aussi parce que des amis photographes ont perdu la vie en travaillant. Je souhaite continuer à exercer ce métier, mais je dois me fixer d’autres limites et je dois trouver la manière dont je peux fournir un travail de qualité tout en restant en vie.
Comment faites-vous pour survivre lorsqu’on vous tire dessus?
Je suis la première à me coucher au sol et à chercher une cachette. Mes photos de combat ne sont pas très bonnes, parce que je n’en fais pas énormément.
Mais comment faites-vous pour sauver votre peau?
Il y a certainement une part de chance. Il est également important de se mettre à couvert aussi rapidement que possible, de rester caché. Grâce à mon expérience, je sais aujourd’hui où me cacher pour survivre.
Quels risques êtes-vous prête à courir pour un bon cliché?
Mon premier but est de survivre. Car, une fois morte, je ne pourrai plus rien faire. C’est pourquoi j’essaie toujours de me mettre d’abord à couvert, par exemple derrière une paroi ou un rocher. Puis, de là, je prends des photos. Si je ne trouve aucune cachette, je quitte les lieux.
Pourquoi les médias font-ils davantage cas de la mort des journalistes que de celle des civils?
C’est très triste, car une vie est une vie. Il ne devrait y avoir aucune différence entre la mort d’un journaliste et celle d’un civil. C’est toujours terrible de perdre quelqu’un. Personnellement, je suis touchée lorsqu’un journaliste meurt, parce que nous formons tous, en quelque sorte, une grande famille. Le témoignage des journalistes est important pour notre société et ils doivent être respectés en tant qu’observateurs neutres. Ils ne doivent pas être tués.
Pourquoi racontez-vous votre vie sentimentale dans vos mémoires?
Au départ, ce n’était pas mon intention. C’est mon éditrice, aux Editions Penguin, qui m’y a encouragée. Justement parce qu’elle est d’avis qu’il est très difficile de mener une vie normale avec ce travail.
Elle a raison.
Mais je craignais que de trop en dire sur ma vie privée nuise à mon travail. Toutefois, c’est clair que cela aide à comprendre à quel point il est difficile de mener une vie normale en tant que journaliste photographe, car on doit être sur place. On doit prendre l’avion dès que quelque chose se passe. On doit quitter ses proches pendant le souper. On rate les anniversaires et les mariages de ses meilleurs amis. On n’est pas là dans les moments qui comptent pour les autres. Peu nombreux sont ceux qui arrivent à le comprendre. C’est de cela que je voulais parler. Je voulais montrer les sacrifices énormes que nous faisons.
Votre compagnon vous a trompée pendant votre absence. L’avez-vous accepté parce que vous le trompiez, en quelque sorte, par votre travail?
Je ne voyais pas encore les choses ainsi, à l’époque. J’étais amoureuse, et cela m’a fait souffrir. Je me demandais comment cela avait pu se produire. J’aime cet homme, pourquoi ne me comprend-il pas? Je l’aime, mais je dois m’absenter pour mon travail. Aujourd’hui, je comprends que l’on ne peut pas quitter quelqu’un deux ou trois mois et s’imaginer qu’il va l’accepter ainsi, tout simplement. On reçoit d’une relation ce qu’on y met. Un jour, il m’est apparu clairement que je ne pouvais pas rater des reportages juste pour être une bonne compagne, à la maison.

Comme si j’entendais un poème! Je me disais: «Le pense-t-il sincèrement? Est-il bien réel?» Paul a lui-même été journaliste pendant très longtemps. Il a travaillé seize ans chez Reuters. Il comprend ce que je fais. Il travaille avec la même passion que moi, il me soutient, et il ne se sent pas menacé par mon dévouement à mon travail. Et c’est la chose la plus importante dans une relation: nous sommes de vrais partenaires. Nous nous comprenons, nous nous respectons et nous savons tous deux que notre passion pour notre métier n’enlève rien à notre relation.
Votre famille et vos proches vivent en permanence sur des charbons ardents lorsque vous voyagez dans des régions dangereuses. N’est-ce pas égoïste de votre part?
C’est un métier solitaire et, oui, c’est dur pour ceux qui nous aiment. Je le sais. Mais le monde a depuis longtemps changé. Aujourd’hui, on n’est pas plus en sécurité à Paris et à Londres qu’ailleurs. Les terroristes ont également ces villes dans leur viseur.
Un de vos collègues qui a été enlevé a déclaré qu’il ne supportait plus cette vie, qu’il arrêtait. En êtes-vous déjà arrivée à ce point?
Non. Mais nous savions tous, après notre enlèvement en Libye, qu’il serait difficile de continuer. J’ai compris que je devais lever un peu le pied. Et trouver la manière d’aller de l’avant. Mais je n’ai jamais pensé à m’arrêter. Cela ne me correspond pas.
Quels reportages vous ont apporté le plus de satisfaction?
Aucun. Je ne suis jamais satisfaite de mon travail. J’ai toujours l’impression, d’une certaine manière, d’avoir échoué.
Quand avez-vous compris que votre vie valait la peine d’être racontée?
Je n’en ai jamais eu conscience. Je suis toujours un peu surprise que les gens aient envie de lire mon livre. Je voulais partir en Libye, faire un livre de photos. Mais mes collègues Tim Hetherington et Chris Hondros ont été tués à ce moment-là. Cela m’a déstabilisée. J’ai abandonné mon projet. De nombreux agents littéraires m’ont contactée après la Libye. Peu de femmes faisant ce que je fais, ils pensaient que je devais raconter ma vie.
Steven Spielberg a acheté les droits de votre livre.
C’est faux. Il n’a pas acheté les droits. Warner Brothers a acheté une option sur le livre.
Cependant, une chose est claire à présent: c’est vous qui êtes devenue un sujet de reportage.
Il est vrai que Spielberg et Jennifer Lawrence sont intéressés. Mais c’est Hollywood. Tout peut encore se casser la figure d’ici au tournage. Le scénario n’est pas encore prêt. Naturellement, c’est un honneur pour moi. C’est surtout un plaisir parce cela concerne des choses qui me tiennent à cœur. Le film pourrait toucher beaucoup de monde, car les films hollywoodiens bénéficient d’une large audience. Hollywood est aussi une plateforme pour aborder les sujets qui sont si importants pour mes collègues et moi.
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous aujourd’hui, l’amour ou votre travail?
Aujourd’hui? Aujourd’hui même? C’est une question très difficile. Peut-être parce que je vieillis. Hum… Sincèrement, je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre. Si vous m’aviez posé la question il y a dix ans, je n’aurais pas hésité. Mais aujourd’hui, je ne peux pas vous répondre de manière catégorique.
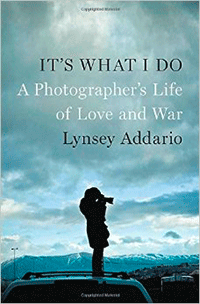
En mars 2011, Lynsey Addario a effectué un reportage photo sur le printemps arabe en Libye. Elle y a été enlevée avec trois de ses collègues. Après sa libération, elle s’est mise à rédiger ses mémoires. Aujourd’hui, elle publie une autobiographie émouvante: «It’s What I Do: A Photographer’s Life Of Love And War». Le livre est devenu un ouvrage de référence sur le journalisme. La photographe y décrit de manière captivante son enfance protégée dans le Connecticut, ses débuts dans la photo en Argentine et à Cuba et sa passion pour son métier. Elle avait effectué des reportages en Afghanistan avant le 11 septembre, elle y est retournée depuis; elle a photographié la guerre en Irak, les atrocités au Congo, la famine en Somalie. Lynsey Addario décrit de manière personnelle et avec sincérité la difficulté de tisser des liens authentiques parallèlement à son métier.
Le studio hollywoodien Warner Bros. a acquis les droits de son autobiographie. Il est prévu que Steven Spielberg («E.T.») réalise l’adaptation cinématographique, avec Jennifer Lawrence («Hunger Games») dans le rôle principal. Le scénario n’est pas encore prêt.